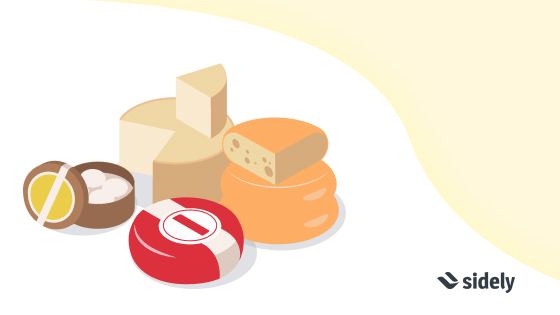

Symbole du patrimoine gastronomique français, le fromage incarne à la fois un savoir-faire ancestral et un secteur économique majeur. Avec près de 26,5 kg consommés par habitant chaque année et plus de 10 milliards d’euros de ventes au détail, la France reste l’un des pays les plus fromagers au monde. Derrière cette passion se cache toutefois un marché en pleine mutation, tiraillé entre tradition, industrialisation, nouvelles attentes de consommation et transition durable.
Alors que les grandes surfaces conservent leur position dominante, les crémiers-fromagers, la restauration et l’export gagnent en importance. Parallèlement, l’innovation, les formats snacking et les fromages alternatifs ouvrent la voie à de nouveaux usages.
Comment le secteur évolue-t-il ? Quelles opportunités se dessinent pour les producteurs, affineurs et marques françaises ?
Cet article propose un panorama complet du marché du fromage en France, de sa structure économique aux tendances de consommation, avant d’explorer les circuits de distribution clés : GMS, CHR et RHD.
Le fromage représente un pilier de la filière laitière française. En 2023, le marché au détail a généré plus de 10,2 milliards d’euros, pour environ 860 000 tonnes vendues. Le pays produit une incroyable diversité de fromages, issus du lait de vache (89 % des volumes), de chèvre (7 %) et de brebis (3 %).
Les fromages sous appellation d’origine (AOP/IGP) - près de 54 variétés - comptent pour environ 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit près d’un tiers de la valeur du marché. En 2023, ils totalisaient 201 176 tonnes d’AOP et 32 606 tonnes d’IGP commercialisées.
Sur la scène internationale, la France reste un acteur majeur : en 2024, elle a exporté 2,28 milliards d’euros de fromages, principalement vers l’Europe et l’Amérique du Nord.
On recense plus de 1 500 variétés de fromages français, réparties entre les grandes familles de pâtes : molles, pressées, persillées, fraîches, filées… Si vous mangiez une variété différente tout les jours, il vous faudrait un peu plus de 4 ans pour toutes les goûter.
Cette diversité illustre l’attachement au terroir : 46 AOP et 8 IGP valorisent le lien entre savoir-faire, lait et territoire. Le Comté reste la locomotive des fromages d’appellation, suivi du Roquefort, du Reblochon ou encore du Saint-Nectaire.
À côté de ces produits d’excellence, les gammes industrielles (Président, Babybel, Caprice des Dieux, Leerdammer…) structurent le volume, garantissant une distribution de masse et une stabilité d’approvisionnement.
Si les Français restent de grands amateurs de fromage, les usages évoluent. Les fromages à pâtes pressées cuites (emmental, comté, raclette) dominent les volumes, tandis que les fromages de plateau reculent légèrement. La consommation s’adapte aux nouveaux rythmes de vie : plus de snacking, de fromage à tartiner ou de produits portionnés.
Les jeunes générations recherchent davantage de sens : origine locale, naturalité, bien-être animal. La tendance “plaisir responsable” pousse les marques à revisiter les formats et à valoriser l’origine du lait.
La conjoncture 2024 a confirmé la sensibilité du marché au prix. Les ménages arbitrent entre qualité et accessibilité, ce qui favorise la montée en puissance des marques de distributeurs (MDD) : environ 40 % des volumes vendus. Les promotions structurent une part croissante des ventes en GMS, tandis que la valeur se déplace vers les fromages d’usage cuisine ou ingrédients (râpé, tranches, fondu).
Le fromage est fabriqué à partir d’un produit phare des débats concernant leur origine. Et pour cause, les consommateurs veulent comprendre ce qu’ils achètent. L’origine du lait est importante, mais que : type d’élevage, empreinte carbone… sont aussi au coeur du débat. Le storytelling produit et le packaging durable deviennent des leviers de différenciation.
Le digital accélère cette transformation : boutiques en ligne, box fromagères, e-commerce GMS ou plateformes locales séduisent une clientèle urbaine en quête de praticité.
Innovation et tradition cohabitent désormais. Les fromages végétaux (à base de noix de cajou, soja ou avoine) connaissent une croissance à deux chiffres, bien que leur poids reste modeste (~70 M€ en 2024). Parallèlement, les fromages allégés, enrichis en protéines ou sans lactose répondent à une demande santé.
Les fromagers revisitent aussi les usages : recettes à cuisiner, snacking frais, formats mini, fromages aromatisés (truffe, herbes, piment).
La réduction du plastique et l’éco-conception des emballages deviennent un enjeu stratégique. Plusieurs acteurs testent des films compostables, du carton recyclable ou des solutions consignées. Ces démarches s’inscrivent dans la transition écologique et valorisent la marque auprès des consommateurs responsables.
La filière fromagère se modernise : traçabilité numérique, automatisation de l’affinage, logistique connectée…
Côté commercial, la digitalisation des forces de vente transforme le quotidien des producteurs et distributeurs. Les outils CRM comme Sidely permettent de suivre les points de vente, d’analyser la performance terrain et de renforcer la relation client, notamment dans les réseaux GMS, CHR et RHD.
Les grandes et moyennes surfaces concentrent 70 à 75 % des volumes vendus. Le libre-service domine, avec des ventes soutenues sur les produits à usage culinaire (râpé, mozzarella, raclette). Les rayons coupe, plus qualitatifs, résistent grâce à la théâtralisation et aux produits régionaux.
→ (Lire aussi : Vendre son fromage en GMS)
Le circuit CHR (cafés, hôtels, restaurants) représente un débouché stratégique, notamment pour les fromages à forte valeur ajoutée. Dans la restauration bistronomique, les plateaux de fromages reviennent en force ; dans la restauration rapide, l’usage ingrédient (cheddar, mozzarella, raclette) explose.
→ (Lire aussi : Vendre son fromage en CHR)
La restauration hors domicile (cantines, entreprises, traiteurs) pèse environ 15 à 20 % de la consommation nationale. Elle favorise les fromages français dans les marchés publics, avec une attention accrue aux circuits courts et aux critères durables.
Solide, diversifié et porteur de valeur, le marché du fromage français demeure l’un des plus dynamiques d’Europe. S’il doit composer avec l’érosion du pouvoir d’achat et la pression concurrentielle, il reste soutenu par la force de son patrimoine, sa capacité d’innovation et son ouverture à l’export.
Pour les acteurs de la filière, les perspectives résident dans la différenciation (AOP, local, bio), l’adaptation aux nouveaux usages (snacking, ingrédients) et la maîtrise de la donnée commerciale.
Les prochaines années verront la montée du digital, de la durabilité et de la personnalisation dans la relation entre producteurs et distributeurs.