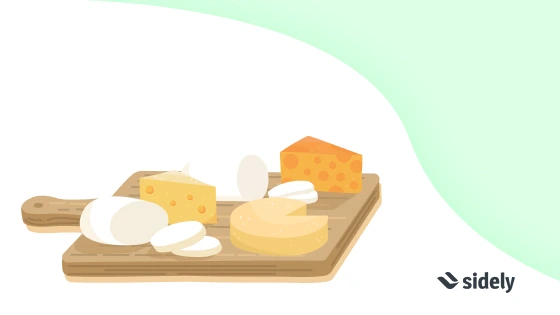

Pour un producteur ou affineur, la restauration commerciale (CHR : café, hôtel, restaurant) représente un canal de vente à forte valeur ajoutée.
Sur le marché du fromage, la vente en CHR repose avant tout sur des relations humaines, la qualité du produit et la régularité du vendeur. Les restaurateurs recherchent des partenaires fiables, capables de proposer des produits cohérents avec leur carte et leur identité culinaire.
Collaborer avec des chefs, traiteurs ou hôteliers demande donc une approche plus spécifique, plus personnalisée et plus souple.
Dans cet article, nous vous proposons un panorama complet des tendances, attentes et bonnes pratiques pour réussir à vendre votre fromage dans les réseaux CHR : du premier contact à la fidélisation.
Le fromage n’est plus un accompagnement : c’est un élément de différenciation culinaire et identitaire.
Longtemps cantonné à la fin du repas, le fromage s’impose désormais comme un ingrédient créatif au cœur de l’assiette. Le traditionnel plateau fromager laisse place, dans certains établissements, à des assiettes composées, plus légères et esthétiques : lamelles de comté sur légumes confits, chèvre frais accompagné de miel ou de confit d’oignon, croûte caramélisée sur une crème de saison… Vous choisissez la recette qui vous plaît !
Ainsi, le fromage devient une signature gustative, travaillée dans le même esprit que les sauces ou les vins.
En parallèle, les formats se diversifient. Planches apéritives à partager, bouchées fondantes, mini-portions snack ou desserts revisités : chaque type d’établissement propose ses combinaisons phares.
Dans le prolongement de cette diversification, l’ouverture de nouveaux concepts contribue à redéfinir la place du fromage dans la gastronomie française et les habitudes de consommation. Bars à fromage, raclettes revisitées, fondues “gastro” : ces formats se multiplient dans les grandes villes et témoignent de la vitalité de la catégorie.
Les restaurateurs recherchent avant tout un produit constant et valorisant.
Valorisant, parce que leurs clients viennent au restaurant pour vivre une expérience, découvrir des saveurs qu’ils ne consomment pas chez eux. Le fromage doit donc surprendre : par sa qualité, son originalité, ou sa capacité à sortir des sentiers battus. Loin du traditionnel comté ou roquefort, pour le dire simplement.
Constant, parce qu’un client revient lorsqu’il sait qu’il retrouvera la même qualité, à chaque visite. C’est aujourd’hui un critère essentiel, à une époque où sortir au restaurant est devenu un choix réfléchi. Les clients ne veulent pas de mauvaises surprises.
Selon l’UMIH (Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière), en 2025, la fréquentation des établissements a chuté de 15 à 20 % par rapport à l’été précédent. Dans certaines zones touristiques, la baisse de chiffre d’affaires atteint même –25 à –35 % pour les bars et restaurants.
Dans un contexte où le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations, chaque sortie doit être à la hauteur. C’est pourquoi les restaurateurs accordent une importance cruciale à la stabilité de l’expérience qu’ils offrent, tout en cherchant à raconter une histoire, à faire voyager leurs clients.
Bref, les sortir du quotidien.
Et oui, un fromage peut aussi faire ça.
Les critères principaux des restaurateurs :
Les fromages qui fidélisent le plus les établissements sont ceux qui allient origine identifiable et cohérence sensorielle.
Le locavorisme transforme profondément l’approvisionnement des restaurants. Plus de 60 % des restaurateurs français affirment privilégier les produits locaux et de saison, selon FranceAgriMer.
Pour le fromage, cette tendance est encore plus marquée : un restaurateur sur deux déclare acheter régulièrement à un producteur ou affineur régional. Et pour cause : c’est un produit qui s’inscrit naturellement dans cette recherche d’origine. Ancré dans le terroir, issu de lait local, souvent protégé par une appellation, le fromage incarne à lui seul l’identité régionale. Seules quelques exceptions, comme la mozzarella ou le parmesan, échappent à cette logique. Mais pour des raisons similaires : ce sont eux aussi des produits traditionnels, étroitement liés à un terroir, même s’il se situe de l’autre côté des Alpes.
Cette approche locavore s’appuie sur trois leviers :
Mais le local suppose aussi de nouvelles contraintes logistiques : volumes irréguliers, livraisons fragmentées, prix plus élevés. C’est pourquoi les producteurs doivent structurer leur offre (mutualisation, coopératives, livraisons planifiées…) pour répondre aux exigences du CHR.
Convaincre un restaurateur demande de comprendre à qui l’on parle. Un chef indépendant n’a pas les mêmes priorités qu’un groupe hôtelier, comme un hôtel n’aura pas les mêmes besoins pour son petit-déjeuner continental que son dîner gastronomique.
Avant de prendre rendez-vous :
Le restaurateur veut comprendre rapidement ce que vous apportez de plus.
Pour cela, appuyez-vous sur un relevé de qualification d’établissement. Il vous aidera à identifier ceux qui représentent un véritable potentiel commercial, et à écarter ceux qui risquent de mobiliser du temps pour trop peu de résultats.
Construire une offre adaptée demande du temps, des ajustements, et parfois plusieurs essais. Il est rare de viser juste dès la première tentative. Pour affiner votre proposition, échangez avec vos clients actuels. Interrogez-les sur ce qu’ils apprécient dans vos produits, vos services, votre logistique. Ces retours concrets vous permettront de concevoir une offre vraiment prête à l’emploi pour les restaurateurs.
Car c’est ce qu’ils attendent : des portions calibrées, des emballages adaptés, des livraisons régulières, et surtout, une simplicité opérationnelle. Ils ne veulent pas avoir à réfléchir : vous êtes là pour leur apporter des solutions, pas des contraintes.
En tant que fournisseur, votre rôle est donc d’être fiable, constant et rassurant. Et cette fiabilité a de la valeur. Elle justifie vos prix. Entre deux options, les restaurateurs choisiront presque toujours celui en qui ils ont confiance, qui leur fait gagner du temps et réduit leur charge mentale.
Formats à privilégier :
Politique tarifaire :
Logistique :
Le fromage se vend par le goût… mais aussi par l’histoire qu’on raconte autour. Une dégustation bien menée peut suffire à déclencher une collaboration. Et c’est votre objectif : obtenir cette première commande qui vous ouvrira les portes de l’établissement.
Les restaurateurs restent fidèles quand la confiance est réciproque. Et cette confiance se construit dans la durée, à travers des gestes simples mais constants : régularité des livraisons, réactivité en cas d’imprévu, transparence sur les conditions… Les mêmes actions qui vous ont permis de convertir votre prospect en client, vous permettront de convertir vos clients en clients actifs.
Et ce sont ces éléments qui feront la différence entre être un fournisseur ordinaire et être un vrai partenaire. Car, il ne s’agit pas de convaincre une fois, mais d’entretenir la relation commerciale. Cela passe par des visites régulières pour discuter de la carte, un appel après livraison pour s’assurer que tout s’est bien passé, ou encore une intervention rapide en cas de souci.
Avec vos clients clés (le fameux 20/80), soyez particulièrement attentif. Un problème non résolu peut vite les faire basculer vers la concurrence.
Faites aussi preuve de souplesse : un geste commercial bien placé fidélise plus qu’un long discours. Et ne vous offusquez pas s’ils travaillent avec d’autres fournisseurs : vous ne pouvez pas couvrir tous leurs besoins. Au contraire, leur laisser cette liberté renforce souvent la relation. En revanche, soyez attentif : ne laissez pas un concurrent leur fournir vos références les plus stratégiques.
Est-ce utile ?
Si vous vendez votre fromage à des bistrots ou restaurants de quartier, l’accompagnement des équipes en salle n’est pas toujours nécessaire. Les cartes y sont souvent simples, avec peu de fromages, et la clientèle demande rarement des conseils très pointus.
Mais un fromage raconté se vend mieux. Si vous proposez une référence méconnue ou originale, prenez le temps de présenter le produit à ceux qui expliquent la carte. Pour cela, passez vers 18h, avant le service du soir. C’est généralement le moment où l’équipe dîne. En prenant 5 minutes (pas plus non plus, vous êtes sur leur pause), vous pourrez capter leur attention sans perturber leur organisation. Sinon, prévoyez un morceau en plus, réservé pour une dégustation en interne, avant le coup de feu.
En revanche, si vous vendez à des restaurants gastronomiques ou étoilés, une formation plus poussée peut faire la différence. L’origine du fromage, son affinage, les accords possibles ou encore les techniques de service peuvent faire partie de l’expérience client.
Dans tous les cas, former les équipes de salle crée une cohérence entre la cuisine et le discours en salle. Une équipe bien (in)formée devient un relais de confiance, et souvent, votre meilleur ambassadeur auprès des clients.
Outils à fournir :
Le suivi commercial ne peut pas reposer uniquement sur la mémoire ou un carnet de commandes papier. Aujourd’hui, un CRM terrain conçu pour le CHR est indispensable pour piloter efficacement votre activité, suivre vos clients du premier contact jusqu’à la fidélisation, et automatiser une partie de vos actions.
Avec un CRM adapté aux réalités du terrain, vous pouvez :
Un bon CRM vous libère du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : la relation client et le développement du chiffre d’affaires.
Vendre son fromage en CHR, c’est bien plus que livrer un produit : c’est créer un partenariat culinaire et humain.
Les restaurateurs recherchent la fiabilité, la proximité et la sincérité.
Pour réussir sur ce marché exigeant, un producteur doit :
Le fromage est un produit vivant.
Et comme tout produit vivant, il demande une relation durable, faite de passion, de rigueur et de confiance.